Le lac Léman
Caractéristiques

Le lac Léman est le plus grand lac alpin et subalpin d'Europe
centrale. Il est situé à l'extrémité ouest de la Suisse et au nord du département
français de la Haute-Savoie. Source:
Office fédéral de l'environnement OFEV
Sa position géographique moyenne est 46° 27' N / 6°
32' E.
Le nom Léman aurait pour origine les termes "lem"
qui signifie "grand" et "an" qui veut dire
"eau" en langage de base celtique.
Sa forme est celle d’un croissant long de plus de 72 km et large au
maximum entre Morges et Amphion de 13,8 km.
Le lac Léman occupe une dépression qui résulte du surcreusement effectué
par l'ancien glacier du Rhône dans une région où les roches, affectées
par des mouvements tectoniques contemporains de la surrection alpine,
offraient une moindre résistance.
La profondeur du lac est actuellement de 309m, mais les terrasses
caillouteuses qui le bordent indiquent qu'il a connu, lors des périodes
froides du Quaternaire, une plus grande extension.
Le lac Léman est traversé, d'est en ouest, par le Rhône, qui colmate de
ses alluvions la partie amont où il édifie un delta (la
Bataillère), ce dernier est constitué par une plaine centrale de 12 km
sur 6 km dont la profondeur maximum est de 309 m, soit seulement 63 m au-dessus du niveau
de la mer. Le Rhône sort à Genève par une percée de l'arc
morainique qui retient le lac.
Un système d'écluses, établi à Genève,
permet d'atténuer les variations du niveau du lac dues aux
irrégularités des régimes des rivières qui l'alimentent (Rhône, Morge,
Veveyse, Venoge, Versoix, Dranse).
L'altitude moyenne du plan d'eau est de 372 m. Le niveau moyen des hautes eaux en été est fixé à la cote 372,3 m. Le niveau moyen des basses eaux en hiver à 371,7 m. Pour les années bissextiles, il est fixé à la cote 371,5 m.
Son niveau actuel

![]() L'Office fédéral de l'environnement OFEV est le service fédéral
compétent en matière d'environnement. L’OFEV gère des réseaux
d’observation et met à disposition des informations en temps réel, des
séries de données sur de longues périodes ainsi que des synthèses sur
les débits, les niveaux d’eau et la qualité des cours d’eau, des lacs et
des eaux souterraines.
L'Office fédéral de l'environnement OFEV est le service fédéral
compétent en matière d'environnement. L’OFEV gère des réseaux
d’observation et met à disposition des informations en temps réel, des
séries de données sur de longues périodes ainsi que des synthèses sur
les débits, les niveaux d’eau et la qualité des cours d’eau, des lacs et
des eaux souterraines.
Caractéristiques principales
Superficie du plan d'eau
580,1 km2
Altitude
moyenne
372 m
Profondeur
maximum
308,99 m
*
Volume
total d'eau
89
milliards de m3
Largeur
maximum
13,8 km
Longueur
dans l'axe
72,3 km
Température
minimum de l'eau
6°C
Temps
moyen de renouvellement des eaux
11,4 ans
* Nouvelle mesure effectuée en 2012 par l'Université de Genève
Bien qu'il ne forme qu'un seul lac du point de vue géographique, on distingue généralement le Petit-lac — peu profond (40 m en moyenne) entre Genève et Yvoire — du Grand-lac, de la pointe d'Yvoire à la Promenthoux, secteur le plus épanoui (d'une profondeur moyenne de 172 m), dont une partie au large de Rivaz et Meillerie est encore appelée le Haut-lac.
Il existe cinq îles sur le Léman
• L'île de Rolle ou île de la Harpe• L'île de Salagnon à Clarens
• L'île de Peilz au large de Villeneuve
• L'île de Choisi, devant Bursinel
• L'île Rousseau à Genève
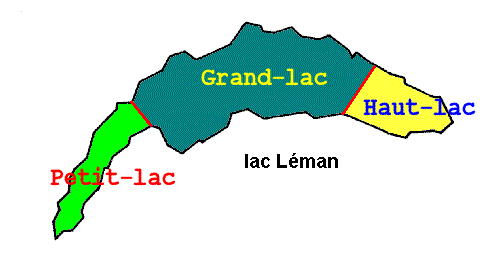
Les principaux affluents du Léman sont le Rhône (débit
annuel moyen de 183 m3/s ce qui correspond à 75 % des apports totaux) et la Dranse avec
21 m3/s.
La pénétration du Rhône dans le Léman (5millions de tonnes/an d'alluvions) a provoqué
la formation d'une vallée sous-lacustre de 15 km de long et 30 m de hauteur qui se
termine dans la plaine centrale où l'épaisseur des sédiments atteint 250 m.
Le Léman est un lac chaud, son volume trop important l'empêche de geler et
en hiver on enregistre la même température de 6°C en surface comme au fond.
La surface totale du plan d'eau est de 580,1 km2 dont
345,3 km2 (59,5 %) pour la Suisse répartit à raison de 298 km2 (51,3
%) pour le canton de Vaud,
36,7 km2 (6,3%) pour Genève et 10,6 km2 (1,8%) pour le canton du Valais. Les 234,8 km2 restant
(40,5 %)
sont sur le territoire français.
La longueur des rives du lac représente 200,2 km de rives, dont 142,2 km pour la
Suisse et 58 km
pour la France.
Source des chiffres :
![]() CIPEL 2004 selon calculs informatiques effectués sur des cartes de l'Office
Fédéral de Topographie au 1:25'000
CIPEL 2004 selon calculs informatiques effectués sur des cartes de l'Office
Fédéral de Topographie au 1:25'000
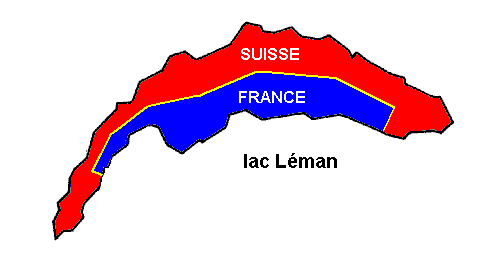
Les plus grandes vagues du lac Léman atteignent des
creux de 1,70 m, la longueur les séparant étant de 35 m.
Les vents entraînant l'eau sur les rives forment un courant de retour profond en sens
inverse. On trouve un courant dû à l'écoulement de l'eau dans le Petit-lac où il a
été calculé que l'eau ne séjourne que 150 jours. Le courant remontant par suite du
rétrécissement du lac vers le Haut-lac, longeant la rive Savoyarde varie entre 3 et 5
m/min.
Un grand lac comme le Léman subit des marées de l'ordre de...... 4 mm.
Le Léman compte environ 70 ports de plaisance dont quelques ports privés et
trois ports marchands. Pour trouver tous les détails sur les ports de
plaisance, suivre ce lien SISL
![]() les ports autour du lac Léman
les ports autour du lac Léman
![]() Les vents soufflant sur le Léman sont particulièrement nombreux puisqu'on en compte
plusieurs dizaines divisées en trois grandes catégories:
Les vents soufflant sur le Léman sont particulièrement nombreux puisqu'on en compte
plusieurs dizaines divisées en trois grandes catégories:
- les vents généraux tels que la bise ou le vent d'ouest
- les vents d'orage tels que la vaudaire ou le bornan
- les brises ou vents thermiques tels que le rebat ou séchard.
Service d'avis des tempêtes

Il existe sur le Léman un service d'avis des tempêtes. Il permet de renseigner les
usagers du lac souvent deux heures à l'avance de l'imminence d'un probable coup de vent
ou orage.
Ces avis de tempêtes sont donnés par 22 phares oranges répartis sur tout le périmètre
du lac.
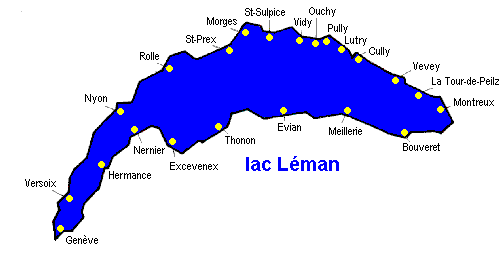
 |
 |
| Avis de prudence | Avis de tempête |
Caractérisés par deux séquences de feux tournants
différents, ils indiquent pour une fréquence de 40 clignotements, un avis de prudence
signifiant l'arrivée de vents tempétueux et pour une fréquence de 90 clignotements, un
avis de tempête imminent. Voir aussi la page
![]() Alarme Météo lac.
Alarme Météo lac.
Téléchargez
une
![]() carte des vents ainsi que l'emplacement des
feux d'avis de tempête installés sur ses rives.
carte des vents ainsi que l'emplacement des
feux d'avis de tempête installés sur ses rives.
Grâce à une ![]() image radar, vous pouvez consulter en temps
réel les précipitations et les orages qui sont ou seront prochainement sur
notre région.
image radar, vous pouvez consulter en temps
réel les précipitations et les orages qui sont ou seront prochainement sur
notre région.
Les principales tragédies sur le Léman
-
Le premier accident grave que l'on déplore sur le Léman depuis le lancement du premier bateau à vapeur, fut la tragédie de l'"HELVETIE" au large de Nyon, en août 1858, qui partagea en deux un bateau radeleur. Seize personnes se noyèrent.
-
Le 10 juin 1862, l"HIRONDELLE'', bateau d'une capacité de 800 personnes, avec 150 personnes à bord, coule au large de la pointe de la Becque à La Tour-de-Peilz. C'est par suite d'une manoeuvre pour éviter une barque qui lui coupe la route que l"HIRONDELLE" toucha les rochers et coula. Pas de victime. Il gît aujourd'hui entre 40 et 65 mètres de profondeur.
-
Le 23 novembre 1883, entre Ouchy et Evian, le "RHONE" sombrait après être entré en
 collision avec le "CYGNE", entraînant dix personnes dans la mort.
collision avec le "CYGNE", entraînant dix personnes dans la mort. -
En 1892, au large d'Ouchy, vingt-sept personnes étaient brûlées vives à bord du "MONT-BLANC", dont les chaudières explosaient.
-
Le 18 août 1969, le "FRAIDIEU", bateau de location de Thonon, avec 61 personnes à bord, dont 33 enfants, coulait devant Ripaille. Bilan 24 morts dont 16 enfants.
-
Le 7 août 1970, renversée par
 un coup de joran
d'une violence exceptionnelle mais prévisible - le feu clignotant de Nyon
l'annonçait depuis un quart d'heure - la "SAINTE-ODILE" chavire devant
Yvoire, avec vingt-six passagers. Bilan : sept morts.
un coup de joran
d'une violence exceptionnelle mais prévisible - le feu clignotant de Nyon
l'annonçait depuis un quart d'heure - la "SAINTE-ODILE" chavire devant
Yvoire, avec vingt-six passagers. Bilan : sept morts.